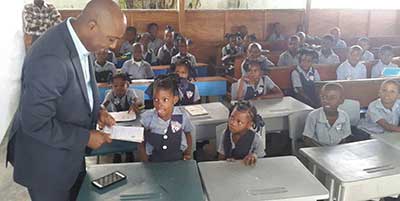
Il y a environ quarante ans depuis qu’Haïti s’est lancée dans une ambitieuse réforme éducative sous la direction du compétent, volontariste et proactif ministre de l’Éducation nationale d’alors, Joseph C. Bernard. Ce dernier s’était donné d’opérer un virage vers la qualité pédagogique et l’utilité sociale de l’éducation. Ainsi voulait-il résoudre le double problème auquel faisait face le système éducatif du pays : le faible taux d’accès à l’éducation et la désuétude des contenus d’enseignement.
Cependant, cette réforme n’a pas pu être totalement effectuée, et ce compte tenu des obstacles sociaux, politiques et économiques. Depuis lors, les différents diagnostics du système éducatif haïtien (PNEF, SNA/EPT, GTEF, PO) montrent clairement que l’État, et plus particulièrement le ministère en charge de l’Éducation, a presque totalement failli à sa mission.
Cela montre que, depuis Joseph C. Bernard, outre les obstacles économiques, une fois les coûteux diagnostics et subséquemment les documents de politique éducative élaborés, aucune volonté de les mettre en œuvre n’a été manifestée. Comme si, en dehors des directives claires et contraignantes conçues et recommandées par les autorités éducatives, les autres acteurs du système éducatif, notamment les responsables d’établissements scolaires et les enseignants, allaient suivre ou mettre en application de manière automatique ces documents.
Ce n’est qu’à partir du mois d’avril 2014 qu’une nouvelle impulsion volontariste, pragmatique et stratégique, tant du point de vue d’une meilleure gouvernance du système éducatif que de l’amélioration de la qualité des contenus pédagogiques, est donnée au système éducatif haïtien. Et pour pouvoir légitimer et rationnaliser cette nouvelle impulsion néobernardiste, des initiatives tant d’ordre intellectuel telles les « Assises sur la qualité de l’éducation » que d’ordre pratique comme les « douze mesures » qui ont été prises. Arrivé au terme de sa gestion, il importe de relater ses grandes réalisations. Pour ce faire, nous divisons celles-ci en trois ordres : gouvernance, accès et qualité.
La gouvernance
Il a été objectivement constaté que le système éducatif haïtien faisait face à un important déficit de gouvernance. En effet, dans le Plan opérationnel 2010-2015, il est constaté que celui-ci est caractérisé par « …la défaillance de la gestion et du pilotage du système ». Face à cette situation, le ministre Nesmy Manigat s’est dit qu’on ne peut plus continuer à piloter à l’aveugle le système et qu’il faut en conséquence changer de schèmes d’action. Car l’éducation n’est pas un secteur que l’État peut prendre à la légère et une activité qu’il peut laisser au bon vouloir affairiste des particuliers, dans la mesure où elle remplit une fonction à la fois de socialisation ou de fabrication des individus et de modernisation nationale.
C’est dans la perspective de redresser la gouvernance du système, comme recommandé dans le rapport du GTEF et le plan opérationnel, que le ministre a pris un ensemble de mesures et entrepris de nombreuses actions de gouvernance.
En effet, il a fait prendre un arrêté présidentiel sur les 12 mesures, et pris 2 arrêtés ministériels créant au sein du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) une commission dénommée Commission nationale de réforme curriculaire (CNRC), et l’Inspection générale de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle.
Il a pris au moins 20 circulaires dont les plus importantes portent sur la réorganisation de la direction générale du MENFP, la constitution d’un corps de correcteurs et d’un bassin de superviseurs et de surveillants aux examens d’État pour un contrôle pédagogique et administratif, l’interdiction de l’introduction de personnes sans lettre de nomination dans les écoles publiques, les cérémonies de graduation dans les établissements scolaires, l’uniforme unique.
Il a entrepris environ 36 actions opérationnelles dont les plus pertinentes sont l’enquête sur la cartographie scolaire ; la mise en place d’une coordination générale pour les programmes de scolarisation rassemblant l’EPT, le PSUGO et le PRONEI ; le recadrage, à travers des consignes ministérielles, de l’enseignement préscolaire ; le recadrage du PSUGO ; la généralisation de la première année du secondaire avec l’introduction dans le cursus de 4 nouvelles matières (économie, informatique, éducation à la citoyenneté et éducation artistique) ; la signature d’un protocole d’accord avec la Plateforme haïtienne des organisations éducatives pour les accompagner dans le renforcement de leurs capacités organisationnelles, et ce en vue de l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la condition enseignante dans le pays ; le recadrage des actions des partenaires (bailleurs de fonds) dans le domaine de l’éducation ; la signature d’accords de partenariat international avec entre autres la Finlande et Cuba ; la signature élargie d’un Pacte national pour une éducation de qualité.
Les actions de Nesmy Manigat sont d’autrant plus importantes que ce qui caractérisait largement la gouvernance du système éducatif haïtien, c’est la rhétorique et l’inertie ou plus précisément la prise de décisions théoriques, au sens qu’on fait des diagnostics et qu’on élabore des plans sans en donner pratiquement suite à travers des actes d’application. L’administration de Nesmy Manigat s’est distinguée dans la mesure où elle s’est plutôt penchée vers des actions concrètes découlant des divers documents de politique éducative.
Par exemple, l’arrêté présidentiel officialisant les 12 mesures constitue un signe d’un grand sens de leadership. Le ministre Nesmy Manigat a bien fait de faire prendre cet arrêté pour instaurer ces mesures, car un arrêté ministériel ou une circulaire n’aurait pas la même force normative et donc les mêmes obligations et durée d’application. Or celles-ci sont nécessaires à l’effectivité de la norme.
Il est à remarquer que cet acte juridico-administratif est la pierre angulaire de la gouvernance du ministre Nesmy Manigat. C’est dire qu’il est désormais la norme légitimatrice et le levier du pilotage du système éducatif haïtien. En effet, les successeurs de ce ministre vont devoir appliquer cet acte afin de pallier les graves problèmes de gouvernance, d’accès et de qualité dont souffre ce système.
La continuité de ces mesures est d’autant plus nécessaire qu’elles partent de l’idée que L’École haïtienne, en tant qu’institution sociale de socialisation et de capacitation professionnelle, est appelée à adapter les jeunes à leur espace-temps et, par voie de conséquence, est sommée de commencer par s’adapter elle-même aux changements survenus tant dans son environnement national qu’international. Dans cette perspective, elles visent à améliorer sa gouvernance, former ses enseignants, rénover ses contenus d’apprentissage et agrandir son accès.
On peut donc dire que ces mesures, si elles sont rigoureusement et durablement appliquées, peuvent grandement contribuer à la refondation du système éducatif haïtien, dans la mesure où elles permettront principalement de contrôler la compétence et l’accès des enseignants aux salles de classe, l’habilité des établissements scolaires à dispenser un enseignement standard de qualité, le rythme et les standards d’évaluation des élèves, et à valoriser la profession enseignante.
Aussi, l’action consistant à adopter l’uniforme unique constitue une action intelligente et progressiste. Elle faisait suite à « l’arrêté présidentiel, signé en Conseil des ministres le 18 mars 2015 ». Selon le MENFP, « cette décision répond à un souci d’intégration, d’égalité de traitement et de sécurité de tous les élèves des écoles nationales et des lycées de la République ». En effet, cette mesure a une portée à la fois symbolique, sociale et économique.
Symbolique au sens que l’uniforme unique constitue un catalyseur pour développer un sentiment d’appartenance des élèves du secteur public.
Social dans la mesure où elle participera à diminuer l’effet distinctif de certains établissements scolaires publics et ainsi rendre faiblement probable l’avènement d’affrontements de rue entre leurs élèves. Économique du fait qu’elle casse les monopoles d’importation de certains tissus et entraîne en conséquence la diminution de leurs coûts pour les parents des élèves, ce qui est très important dans la mesure où il s’avère que les coûts de scolarité, qui comprennent le coût des tissus destinés à la confection des uniformes, représentent le principal obstacle empêchant les enfants d’avoir accès à l’école ou à y rester.
Enfin, le « Pacte national pour une éducation de qualité » est un instrument qui a une grande portée sociopolitique. Autrement dit, il représente un acte supraadministratif qui cherche une double légitimité d’impartialité et de réflexivité. En effet, par cette action, le ministre Nesmy Manigat tente de trouver un consensus autour de « la question éducative haïtienne », laquelle demande une réponse adéquate en vue du développement du pays.
À travers ce pacte « Le gouvernement de la République d’Haïti, la communauté éducative, les partis politiques et les secteurs organisés de la société civile ont, à l’issue de leur entente, convenu ce qui suit :
Engagement no 1 : Accroître et réhabiliter l’offre publique scolaire ;
Engagement no 2 : Doubler au moins le financement de l’éducation ;
Engagement no 3: Soustraire le système éducatif du clientélisme et des influences politiques néfastes ;
Engagement no 4 : Mettre en œuvre le statut particulier des personnels de l’éducation ;
Engagement no 5 : Promouvoir la formation « tout au long de la vie » ;
Engagement no 6 : Développer et améliorer la qualité de l’enseignement technique et professionnel ;
Engagement no 7: Réguler et moderniser l’enseignement supérieur. »
Ces engagements se révèlent pertinents du fait que l’offre scolaire publique en Haïti s’avère dérisoire et donc inacceptable. Or la faiblesse de cette offre est fortement liée à la faible part du budget national (eu égard aux graves problèmes du système éducatif) consacrée au secteur de l’éducation, laquelle a un impact aussi bien sur l’accès que sur la qualité de l’éducation.
À suivre : l’accès et la qualité
Par Fritz Dorvilier – PHD





